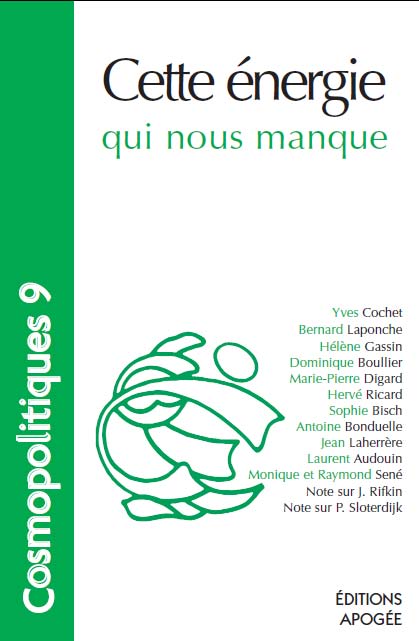
Cosmopolitiques : En tant que militante de la réduction des risques, vous avez participé à différents collectifs. Comment expliquez vous que l’articulation entre les mouvements sociaux et une expression politique cohérente soit si difficile à réaliser ?
Anne Coppel : C’est vrai qu’à l’heure actuelle le militantisme associatif a le vent en poupe, et que cela ne semble malheureusement pas nourrir l’expression politique, des Verts notamment, alors même que les associations écologistes se multiplient. Mais il ne faut pas se leurrer. La force d’une association, et même d’un collectif d’associations, ne repose le plus souvent que sur une petite poignée de personnes, qui se regroupent ponctuellement, pour atteindre un objectif précis. Une fois l’objectif atteint, les liens se desserrent. Le collectif inter-associatif « Limiter la casse » s’est constitué en réponse à un appel publié dans le Monde en octobre 1993. Nous dénoncions la situation dramatique des toxicomanes et nous appelions à des mesures d’urgence. Le collectif regroupait quarante-huit associations, essentiellement issues de la lutte contre le sida mais également quelques associations humanitaires comme Médecins du Monde, des professionnels du soin, des médecins généralistes et enfin des associations que des usagers de drogues avaient créées. Mais y compris dans les temps forts de cette mobilisation, les membres vraiment militants n’étaient qu’une trentaine. En fait la force du mouvement venait de ce qu’il fonctionnait en réseau sur la base d’une même prise de conscience : l’urgence de la situation. De proche en proche, de nouvelles façons de faire ont été expérimentées (prescriptions médicales, accueils des usagers, équipes allant sur le terrain dans la rue, dans les squats…). En 1994, le Ministère de la santé a développé ces actions dans le cadre d’un dispositif expérimental et très vite, les acteurs se sont démobilisés. Le collectif inter-associatif « Limiter la casse » s’est dissous en 1997. Ce qui nous avait réuni, c’était l’exigence d’une politique de santé publique et pour la grande majorité des acteurs, c’était désormais à l’Etat de prendre la relève. Le problème, c’est qu’il ne suffit pas d’exiger une politique de santé publique. Encore faut-il que des acteurs la mettent en place – à moins de rêver à la création d’un grand service public de prévention, avec des fonctionnaires distribuant des seringues dans les squat ! Comme toujours dans l’action socio-sanitaire, l’action sur le terrain devait être déléguée à des associations. C’est effectivement ce qui s’est passé mais ce développement se heurtait à de multiples obstacles, aux croyances collectives, aux logiques institutionnelles ; il fallait inventer de nouvelles façons de faire ce qui exigeait une nouvelle forme de militantisme, d’autant que si le principe de la réduction des risques avait été accepté dans le cadre sanitaire, par contre ni la classe politique ni plus généralement l’opinion publique n’avait participé au débat ; cette politique de santé publique s’est développée de façon quasi clandestine. C’est ce qui nous a amené à créer une nouvelle association, l’Association Française de Réduction des risques (AFR). Passer de la dénonciation à l’action exigeait de formuler un projet commun. Il nous fallait aussi nous doter d’une organisation, alors que nous avions jusque là fonctionné en réseau. Pour moi, le projet était clair : face à l’usage de drogue, nous avions obtenu une réponse médicale, réponse qui s’était révélée nécessaire et même vitale, mais il fallait maintenant s’engager dans une bataille « sociétale » et répondre aux différents problèmes que soulève l’usage de drogues. Je pensais, et je pense toujours, qu’il nous fallait affronter la demande sécuritaire avec des réponses aux toxicomanes problématiques. Il nous fallait faire le lien avec les politiques de lutte contre l’exclusion. Ou encore avec les politiques de la jeunesse, pour ce qui concerne le cannabis. C’est la raison pour laquelle un des premiers projets de l’AFR a été la rédaction d’un guide pour les élus. Mais un tel projet implique de mener à bien une réflexion d’ensemble, de partager une même analyse du problème, une même conception de l’action. Cela n’a pas été possible. Seuls les acteurs du dispositif institutionnel sont restés mobilisés et la mobilisation est devenue purement défensive, notamment lorsque le dispositif a été menacé, et tout d’abord par des restrictions budgétaires. L’AFR fonctionne désormais comme une sorte de syndicat qui regroupe les acteurs du dispositif institutionnel. Le problème, c’est que les restrictions budgétaires ont une signification particulière dans ce domaine : c’est en fait le principe de la réduction des risques qui est remis en cause. Distribuer des seringues ou des kits d’information sur le snif à moindres risques est toujours assimilé à du laxisme et cela reste inacceptable pour la grande majorité de la classe politique. Dans ce secteur, il ne suffit pas d’exiger que « L’Etat prenne ses responsabilités », ce qui a été l’objectif commun des acteurs. Cette demande d’Etat a quelque chose de paradoxal, dans ce secteur associatif, qui spontanément serait plutôt assez libertaire et qui pourtant a bien recherché et obtenu un soutien de l’Etat – ou plus précisément, de l’administration de la santé.
Cosmopolitiques : Mais cette « demande paradoxale d’Etat » n’est-elle pas particulièrement insatisfaite à l’heure actuelle avec la diminution drastique des subventions versées par l’Etat ?
Anne Coppel : La demande est paradoxale mais elle s’inscrit dans la tradition de l’action sociale. Dans des secteurs comme le handicap ou le troisième âge, l’Etat a pris le relais de l’action bénévole avec la création de dispositifs institutionnels spécialisés. C’est un peu ce qui se passe dans ce secteur, celui de l’action auprès des usagers de drogues, mais est-ce vraiment possible ou même souhaitable ? Effectivement, le problème se pose d’abord en termes budgétaires. Les budgets sont venus en complément de l’action bénévole et ils sont d’autant plus insuffisants que le bénévolat s’est désinvesti. A AIDES, comme à Médecins du Monde (MDM), qui sont des acteurs-clé dans ce secteur, l’action auprès des usagers de drogues avait valeur de démonstration, dénoncer une carence, montrer comment faire pour y répondre. Ni AIDES ni MDM ne souhaitent devenir des acteurs du dispositif insti
tutionnel, le problème, c’est que lorsque ces acteurs se désinvestissent, il n’y a personne pour prendre le relais. Il s’est produit le même phénomène en ce qui concerne les accueils pour les exclus ouverts par MDM. L’ambition de MDM était de donner une visibilité aux besoins de ces exclus du soin, de donner accès au droit commun et surtout pas de s’y substituer, avec une médecine précaire pour précaires. MDM a bien proposé une série de mesures afin que le dispositif généraliste s’ouvre aux précaires ; certaines des mesures ont bien été prises mais manifestement elles ne suffisent pas. Aujourd’hui, si MDM se retire, les exclus seront toujours aussi exclus. Un des problèmes, je crois, tient à la contradiction entre populations particulières et droit commun. Dans l’action sociale, le militantisme se développe à partir des besoins d’une population particulière. Cela a créé une masse de dispositifs spécialisés que les pouvoirs publics s’efforcent, à juste titre, de réintégrer dans le droit commun. C’est le cas, par exemple, de l’hébergement thérapeutique mis en place par les militants de la lutte contre le sida. Cet hébergement est subventionné mais est-ce un besoin prioritaire ? Autrement dit, faut-il avoir le sida pour bénéficier d’un appartement thérapeutique ? La réponse est évidemment non et il a été demandé aux associations sida d’ouvrir leurs hébergements à d’autres pathologies. Or les militants de la lutte contre le sida n’avaient pas prévu de devenir des professionnels de l’hébergement social. Les bénévoles à l’origine de l’action perdent leur motivation. Mais au-delà de la motivation, chaque population a ses spécificités qu’il faut connaître, pour lesquelles il faut développer des savoir-faire particuliers. Le problème, c’est le fonctionnement du droit commun, qui s’adresse à un usager-type, qui n’a ni âge, ni sexe, ni pratiques particulières. Les associations qui se plient à ces exigences généralistes apprennent à faire des bilans d’activités qui justifient les demandes de subventions mais ces savoir-faire gestionnaires ont tendance à se substituer aux savoir-faire expérimentés sur le terrain auprès des populations particulières. Ainsi, en est-il de la prévention. Elle se veut généraliste et non pas spécialisée sur les drogues illicites, logiquement, elle doit intégrer l’alcool et plus généralement encore l’ensemble des conduites à risques. Cette exigence génère de nouvelles pratiques, les acteurs vont dans les écoles mais l’action hors institution est délaissée. Or personne, aujourd’hui, n’est en mesure d’évaluer ce que font ces acteurs de prévention. La régionalisation qui devait favoriser une meilleure prise en compte des réalités locales se fait sans que soient définis les objectifs de l’action et donc leur réalisation. Personne n’a pris en compte ce qui a fait l’efficacité de l’action au temps où elle était expérimentale, les savoir-faire spécifiques à des populations particulières ou encore, les accueils en urgence de tout public, sans exigence préalable. De telles pratiques vont à l’encontre des logiques institutionnelles, elles se perdent au fur et à mesure que l’action se professionnalise.
Cosmopolitiques : Votre expérience associative vous a conféré une expertise et à ce titre vous avez été sollicitée par différents collectifs ?
Anne Coppel : Oui, on m’a demandé par exemple de siéger comme représentante des usagers du système de santé à la Conférence régionale de santé d’Ile de France. Je devais représenter quelque 12 millions d’usagers de la santé que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas. Quelle pouvait être ma légitimité pour discuter des priorités du Haut Comité de Santé Publique, et de leurs déclinaisons régionales alors que je ne connaissais rien des besoins d’usagers que je n’avais aucun moyen de consulter. Juste un exemple : lors de la conférence nationale qui regroupe les conférences régionales, j’ai appris que le représentant des usagers de la santé de Bretagne avait soulevé le problème de la pollution des nappes phréatiques ; il demandait une étude et j’ai soutenu sa demande mais à l’époque, nous étions en 1997, le haut comité de santé publique avait écarté toutes les questions de santé liées à l’environnement. Mais à vrai dire, je n’avais pas l’expertise qui me permettait de discuter les priorités retenues : qu’est-ce qui était plus important, la dépendance des personnes âgées, le cancer ou la pollution de l’eau ? Quant à l’action auprès des usagers de drogues, qui était à l’origine de mon engagement et de ma présence dans ces conférences, inutile de dire que je n’ai même pas pu soulever le problème. J’ai bien tenté de le faire mais moi-même, je devais bien reconnaître que la question était modeste au regard du système de santé…. D’ailleurs, quelle est la valeur de l’expertise et sa légitimité lorsqu’on passe d’un cadre d’action sectorielle à une pensée plus globale ? En quoi mon expertise en matière de drogue me permettait-elle de discuter des priorités de santé publique ? J’ai été confrontée au même type de contradiction lorsque j’ai adhéré au parti des Verts. C’était en 2000, j’y suis entrée au moment de la campagne pour les européennes, menée avec Daniel Cohn-Bendit. Cette campagne avait regroupé des gens dont je partageais en grande part à la fois les analyses sociétales et les façons de pratiquer la politique. J’avais espéré qu’il y avait là une dynamique. C’est ce qui m’a fait sauter le pas et passer du statut de « sympathisante », ce que je suis depuis plusieurs années, à celui de militante. C’était enfin l’occasion d’inscrire l’action que je voulais mener dans le secteur des drogues dans une logique plus globale, qui se voulait écologique : comment usagers de drogue et non-usagers peuvent-ils co-exister ? J’espérais donc un développement de mon action associative. Ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. C’est même exactement le contraire. Le soutien que pouvaient m’apporter les Verts de l’extérieur était bien plus efficace. D’autant que si je m’étais pliée aux exigences du parti, aux débats internes, il ne me restait plus guère de temps pour l’action militante sectorielle. Car là encore, il me fallait bien reconnaître que ma petite question, la question des drogues, n’avait rien d’une priorité politique.
Cosmopolitiques : Vous n’avez pas cherché à participer à la commission drogue ou à la commission santé ?
Anne Coppel : La politique des drogues ne relève pas que de la santé. Pour ce qui est de la commission drogue, c’était précisément le premier obstacle pour moi. La question des drogues n’a pas véritablement été débattue chez les Verts, d’ailleurs nombre de militants ignorent tout simplement que leur parti est anti-prohibitionniste et la majorité n’est tout simplement pas d’accord. Les Verts ont délégué ce problème au CIRC, association qui porte le débat sur le cannabis depuis 1992-1993. Je reconnais que la question du cannabis est symbolique de la politique française des drogues. L’essentiel de la répression porte sur le cannabis et c’est un scandale, car répression il y a bien. Cela dit, la question des drogues ne se limite pas au cannabis et surtout, elle ne doit pas se limiter pas à dénoncer la répression, à demander le changement de la loi, d’autant que le changement que demande cette commission, c’est l’arrêt de la prohibition, autrement dit la révolution. Ce n’est pas ma conception de l’action dans ce domaine.
En attendant le soir du grand soir, il y a d’ores et déjà des changements en cours, et ce sont ces changements qu’il faut soutenir, en Europe comme en France. Les actions comme par exemple les salles de consommation sont expérimentées sur la base d’une négociation entre des gens qui a priori ne sont pas d’accord entre eux. Ce peut être des acteurs qui ont des objectifs différents, tels que protéger la santé des usagers pour les uns, répondre aux nuisances pour les autres. Ou encore des acteurs dont les uns sont anti-prohibitionnistes, les autres prohibitionnistes, sans compter ceux qui n’ont pas d’opinion toute faite. Dans les pays européens, ces expérimentations ont été développées par les élus locaux et c’est à eux qu’il faut, selon moi, s’adresser. Ce n’était pas la problématique de la commission toxicomanie des Verts, animée par des militants associatifs que je connais depuis plus de 10 ans, dont j’avais soutenu, à plusieurs reprises, la lutte sur le cannabis mais qui n’ont aucune prise sur les réalités locales. Participer à la commission toxicomanie telle qu’elle était n’avait pas de sens. Il m’aurait fallu réunir les gens qui pouvaient s’investir dans ces nouvelles orientations, autrement dit, commencer par reconstruire cette commission. Cela exigeait aussi que je commence par m’implanter dans le parti, pour construire ma crédibilité puis construire le cadre du débat, développer des outils organisationnels, techniques – précisément ceux que je devais également développer dans le militantisme associatif, avec un poids en moins, celui de l’organisation des Verts– soit une stratégie à mener sur plusieurs années. Mais je n’ai pas eu l’énergie de porter tout cela.
Cosmopolitiques : Avez-vous été sollicitée pour votre expertise par d’autres partis politiques ?
Anne Coppel : Je dirais plutôt que c’est moi qui ai tenté, à plusieurs reprises, de les solliciter, et uniquement à gauche, parce que je n’ai pas de voie d’entrée à droite. J’ai participé à nombre de commissions, essentiellement au PS, avec très peu de résultats, pour ne pas dire aucun. Je me souviens que mes amis et moi avions investi la commission toxicomanie du PS que nous avions convertie à la réduction des risques en 1994 je crois, avec comme résultat que cette commission n’a pas été consultée, la prise de décision se passait ailleurs, ou plus précisément la non-prise de décision. Il y a bien une politique des drogues mais cette politique est la résultante de mesures qui répondent à des objectifs souvent contradictoires et qui s’accumulent pour un résultat que personne n’a véritablement souhaité et d’ailleurs qui n’est pas connu. On ne connaît pas par exemple le nombre d’usagers incarcérés pour usage, nombre que j’évalue à quelque 5000 par an. Personne n’a véritablement décidé que l’essentiel de la répression devait porter sur les usagers de drogue, dont 90% sont des usagers de cannabis. D’ailleurs les services de police ne s’en vantent pas, ils préfèrent laisser penser qu’ils luttent contre le trafic. Sous le gouvernement Jospin, la MILDT, pilotée par Nicole Maestracci, a fait l’effort de penser l’ensemble du dispositif. Des objectifs ont été définis, pour la première fois sur la base d’une expertise. Pour la première fois, aussi, la recherche, l’information, la formation ont été prises au sérieux. À mon sens, c’est même le domaine où les résultats de la politique menée par le gouvernement Jospin sont les meilleurs et les moins contestables. Il faudrait plutôt dire « sous le gouvernement Jospin » que « par », car à vrai dire, la politique menée n’a pas été un choix politique au sens où elle n’a pas été débattue par les parlementaires ni plus largement dans la société civile. Rien d’étonnant si cette politique a été passée sous silence, le débat a été explicitement interdit par Jospin, c’était même la principale contrainte imposée à la MILDT. La MILDT a fait au mieux dans ce contexte, elle a fait appel aux experts. Le problème, c’est qu’aucune politique ne peut prétendre reposer exclusivement sur l’expertise. Traditionnellement, la guerre contre la drogue se prévaut du consensus puisque a priori, personne ne peut être pour les drogues. La MILDT a elle aussi justifié sa politique par un nouveau consensus qui faisait appel à l’expertise, aux connaissances scientifiquement validées. On peut évaluer de façon scientifique les risques liés à tel type de consommation pour tel type de produit mais ensuite, il appartient à chacun d’évaluer les risques qu’il veut bien prendre, y compris les risques de la répression. La loi peut interdire mais pour que l’interdit soit efficace, il faut que l’interdit soit intégré. Il est possible que nous finissions par renoncer au tabac. C’est le débat actuel. Toute la question est de savoir dans quelle mesure peut-on convaincre ceux qui consomment des drogues de renoncer à consommer, dans quelle mesure et à quels coûts humains, financiers, politiques on peut les contraindre, dans quelle mesure vaut-il mieux accepter ces consommations pour en réduire les risques. Ces questions relèvent d’une sorte de négociation entre ceux qui consomment et ceux qui ne consomment pas. C’est d’ailleurs l’origine de la politique de réduction des risques. En 1976, à Amsterdam, les habitants du quartier chaud se sont plaints des nuisances liées au trafic de rue. Pour cette municipalité, quand il y a un problème, il faut mettre autour de la table des acteurs en présence. C’est ce que la ville d’Amsterdam a fait avec les associations d’habitants et de commerçants, les centres de soin, les policiers. Un acteur manquait, c’était les toxicomanes eux-mêmes. Aussi la ville d’Amsterdam a-t-elle procédé comme elle fait dans d’autres problèmes ; elle a suscité une association pour avoir un interlocuteur. Telle est l’origine du premier « syndicat des junkies ». « Il y a nuisances dues à votre présence » ont dit les habitants. « C’est parce que la vente est interdite » a répondu le syndicat des junkies. La ville d’Amsterdam s’est alors posé sérieusement la question de savoir s’il était possible de délivrer de l’héroïne mais, compte-tenu des conventions internationales, la ville s’est contentée de mettre à disposition un bus de distribution de méthadone ; bien sûr ce n’était pas de l’héroïne mais du moins, les toxicomanes n’étaient plus en manque. Je ne vais pas raconter toute l’histoire qui a eu de nombreux développements mais ce que je veux retenir ici, c’est le pragmatisme allié à l’humanisme qui a conduit la ville d’Amsterdam à rechercher les réponses aux besoins de tous ses concitoyens. Or, plus on prend en compte les gens tels qu’ils sont et plus on leur offre la possibilité de faire des choix, de changer. C’est là un effet paradoxal de ce qu’en France nous avons interprété comme du laxisme, mais que certains ont interprété, avec plus de raison à mon avis, comme de nouvelles formes de contrôle social. Cela dit, ceux qui dénoncent ce contrôle social passent sous silence que l’alternative se situe entre contrôles sociaux et contrôles policiers, qui est la pratique française. Pour moi, ce qui est novateur, c’est la démarche de négociation qui aboutit à l’expérimentation de nouvelles modalités de gestion des drogues, licites et illicites. C’est ce pragmatisme des élus de proximité qui manque en France. La démocratie locale ce devrait être comme un laboratoire permettant l’expérimentation de nouveaux modes de gestion, avec un bilan, une évaluation des résultats, une possibilité de mise en réseau des collectivités locales ayant connu des problématiques similaires. D’ailleurs c’est précisément ce que
préconise au niveau européen l’Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies, qui recense et évalue déjà les politiques locales concernant l’usage des drogues.
Cosmopolitiques : Comment concrètement rassembler au niveau local toutes les personnes concernées par un même problème, mais qui n’ont jamais l’occasion de se parler dans la vie quotidienne, pour les faire réfléchir ensemble sur ces questions ?
Anne Coppel : Rassembler les parties prenantes, c’est d’abord les identifier. « Les habitants » ne sont pas un groupe homogène qui puisse parler d’une seule voix. Être à l’écoute du terrain, c’est comprendre ce que font, ce que vivent et ce que pensent ceux qui co-existent dans un même territoire. Cela exige une « construction du problème ». Le quartier de la Goutte d’or, Barbès, la place Stalingrad ou ses alentours sont ce qui s’appelle des « scènes ouvertes », c’est-à-dire que les drogues y sont vendues et consommées. Pour autant ces « scènes ouvertes » sont à peine visibles dans les statistiques de police. La principale évolution repérable dans les statistiques, c’est la progression des interpellations d’usagers de cannabis ; il y a bien des interpellations pour trafic, mais compte-tenu des quantités de drogue saisies, de 1 à 2 doses, comment les distinguer des interpellations d’usagers ? Comme pour la violence vécue au quotidien, il faudrait des études très spécifiques pour appréhender le trafic et ce qu’il fait peser dans la vie quotidienne des habitants qui vivent en proximité. Ou plus simplement il faut accepter de prendre en compte ce qui est dit par certains, non comme vérité universelle mais pour ce que c’est, ce que vivent certains des habitants. Pour qu’une concertation locale soit crédible, pour que les gens s’y reconnaissent, il faut faire entendre les voix de tous ceux qui sont concernés. Je pense aux usagers de drogues mais aussi à leurs familles, réduites comme eux au silence. Je n’ose pas dire les trafiquants mais il faut parvenir à comprendre comment les jeunes d’un quartier peuvent être amenés à faire du trafic de rue. Il faut enfin penser à tous ceux qui n’osent pas prendre la parole, parce qu’ils ne se sentent pas légitimes, parce qu’ils ne sont pas en règle ou pour toute autre raison. Dans des quartiers comme Barbès, cela finit par faire du monde. C’est en faisant entendre toutes ces voix qu’on répondra le mieux aux solutions simplistes, aux « yaka » sécuritaires comme à l’indifférence de ceux qui peuvent échapper aux contraintes de la cohabitation.
Cosmopolitiques : Est-ce qu’il n’est pas choquant de ressentir le besoin, pour organiser un débat citoyen, ou une conférence de consensus, d’assurer une sorte de « remise à niveau » des connaissances des participants ?Est-ce que ce n’est pas aux partis politiques, qui regroupent une grande variété d’individus, d’organiser des modes de concertation qui n’existent pas spontanément dans la société, tout en assumant l’orientation politique des débats, puisque les militants d’un parti ont en général une sensibilité commune, même si elle reste peut-être parfois intuitive ?
Anne Coppel : La remise à niveau est indispensable : pour mener un débat, il faut parvenir à identifier quels sont les choix. « Distribuer des seringues ou chasser les toxicomanes du quartier », ce sont les termes dans lesquels la demande sécuritaire formule le choix en matière de drogue. Rien d’étonnant. Traditionnellement, chaque fois que des habitants dénonçaient la présence de toxicomanes dans le quartier, les élus s’engageaient à agir, c’est-à-dire à les chasser du quartier. Le débat ne peut être mené sans un bilan des politiques menées, c’est-à-dire sans le constat de l’échec de cette politique. C’est facile à faire parce que les habitants de ces quartiers savent par expérience que chaque fois qu’on chasse les toxicomanes d’un quartier, ils resurgissent dans un autre. Le problème, c’est qu’aucun parti politique (à l’exception des Verts) n’a accepté d’engager le débat sur la base de ce constat d’échec. Il y a pourtant des choix de société fondamentaux : aux Etats-Unis, le choix qui a été fait, c’est l’incarcération systématique, soit environ 1 à 1,5 millions de prisonniers. Nous n’avons pas fait ce choix mais nous n’avons pas non plus fait le choix d’alternatives claires, en développant des politiques sociales à la mesure du problème. Nous faisons l’autruche. Le résultat c’est la progression continue de la demande sécuritaire. Je considère que c’est une menace qu’il faut prendre au sérieux. Cela dit, même si les partis politiques acceptaient d’ouvrir le débat sur le dispositif national de lutte contre la drogue, la concertation locale resterait utile. Car même si les habitants d’un quartier, d’une ville ou d’une région acceptent de chercher des alternatives à la réponse répressive pour l’usage, il reste des choix selon les priorités qu’on se donne, selon ce qui est acceptable ou non, selon les moyens qu’on peut mobiliser, selon surtout la nature des problèmes. Il est des drogues illicites comme il en est du tabac. Les choix doivent être discutés, du niveau le plus sociétal au niveau le plus institutionnel.
Cosmopolitiques : Est-ce que les oppositions classiques droite-gauche, qui fondent le fonctionnement institutionnel, ont aidé à clarifier le débat sur les drogues ou non ?
Anne Coppel : Dans ce domaine associatif, tous les acteurs sont de gauche, ou d’extrême-gauche. Ils ne cessent d’oublier qu’en la matière, c’est très systématiquement la droite qui a pris les mesures, Barzach en1987, avec la mise en vente libre des seringues, Simone Veil avec la création du dispositif institutionnel et la légalisation des traitements de substitution entre 1994 et 1995. On peut même remonter plus loin, puisque le premier rapport sur les drogues, le rapport Pelletier en 1978, sous Giscard, a préconisé de ne pas envoyer les usagers de cannabis en prison. C’est donc à chaque fois la droite ou plus précisément des femmes de droite qui ont osé penser et osé faire. Sur la réduction des risques, Kouchner a bien ouvert le débat dès Octobre 1992 mais il s’est heurté à l’opposition catégorique de son gouvernement. Au contraire, avec Quilès comme ministre de l’Intérieur, la répression a été renforcée, renforcement dont Pasqua, qui lui a succédé, a bénéficié auprès de l’opinion mais en matière, il n’a fait qu’emboîter le pas aux mesures déjà prises. C’est sous Quilès que les policiers piétinaient les seringues et interpellaient les usagers de drogues à proximité immédiate du bus distributeur de seringues ; 1993 est même l’année où il y a eu le plus de morts. Simone Veil ne s’est pas contentée d’imposer les mesures à son gouvernement, elle est montée à l’assaut de Bercy pour subventionner les actions et elle a levé pas à pas les nombreux obstacles institutionnels pour que les projets soient mis en oeuvre dans l’année – un record pour la France où généralement les projets exigent 2 à 3 ans de négociation. Tout le dispositif a vécu sur cette mobilisation. Le travail de la MILDT sous le gouvernement Jospin a été d’intégrer ce dispositif d’exception dans le cadre général de la lutte contre la toxicomanie, de rechercher une cohérence globale, mais pas de développer ou même de conforter le dispositif en question. Le résultat a été que le disposit
if fondé sur le bénévolat a été de plus en plus fragile, dans l’incapacité de faire face aux objectifs qui lui étaient assignés. Encore une fois, c’est la droite qui a donné un statut légal au dispositif dans le cadre de la loi de santé publique votée en 2004. La mesure a été prise après un rapport du Sénat, au départ persuadé que les gouvernement Jospin avait été « laxiste » mais qui a découvert que, compte-tenu des résultats, il était impossible de supprimer les traitements de substitution et la prévention du sida… La guerre à la drogue s’est donc focalisée sur le cannabis.
La construction du débat oppose traditionnellement les partisans de la guerre à la drogue, avec la référence aux valeurs d’ordre et d’autorité, à ceux qui privilégient les libertés individuelles. Ce cadre d’interprétation a rendu invisibles les réalités de terrain, la santé publique d’abord, qui a fini par émerger sous la menace du sida. Quant aux effets de la répression, ils ne sont toujours pas identifiés. Dans les représentations (y compris dans les miennes), la répression est de droite et la prévention est de gauche mais dans ce secteur particulier, personne en France ne croit que la prévention puisse avoir une efficacité. Les Français, à gauche comme à droite, sont persuadés que la loi, l’interdit est le seul rempart efficace. Ainsi la prévention est-elle assimilée au laxisme, à l’exception des plus libertaires qui dénoncent le contrôle social. Comme dans la lutte contre la délinquance, la gauche est sur la défensive mais ce n’est pas seulement qu’elle a peur d’être incriminée de laxisme, c’est aussi qu’une grande majorité est profondément moraliste ; les drogues lui font horreur. Si on revient au débat initial, libertés individuelles opposées aux valeurs d’ordre et d’autorité, la ligne de démarcation n’est pas entre la gauche et la droite mais entre deux conceptions de la société, dans les drogues comme dans les autres débats sociétaux. Les acteurs associatifs de ce secteur restent majoritairement attachés à la gauche, par tradition ou par principe, mais de gouvernement de gauche en gouvernement de gauche, chaque génération apprend à son tour qu’on ne peut en attendre grand chose. Aussi les relations avec la classe politique sont-elles purement fonctionnelles ; elles sont limitées aux hommes politiques en place.
Cosmopolitiques : Au sein des Verts comment les élus et les militants anti-prohibition peuvent- ils cohabiter, est-ce que les choses changent dès lors qu’un parti a beaucoup d’élus ? Les élus, les experts, les militants, voilà ceux qui parlent (on pourrait ajouter les médias) est- ce que tous finalement n’ont pas intérêt à laisser les usagers des drogues sans parole et sans organisation, pour garder la politique comme leur domaine propre ?
Anne Coppel : Comment cohabitent anti-prohibitionnistes et prohibitionnistes au sein des Verts ? En s’ignorant ! La parole a été monopolisée par les militants anti-prohibitionnistes ; ceux qui ne sont pas d’accord sont absents du débat. Pourtant, pour une majorité de Verts, il est exclu de mettre les drogues en vente libre, et lorsque les élus Verts sont interpellés sur cette question, ils donnent leur propre position ; mais en général, aucun Vert ne se reconnaît dans les partisans de la guerre à la drogue, tous ceux qui avec Mme Boutin se sont manifestés récemment au Parlement. Ce qui se passe chez les Verts, c’est ni plus ni moins que ce qui se passe en France. Le débat sur les drogues oppose des prises de position qui paraissent extrêmes, guerre à la drogue d’un côté, anti-prohibitionnisme de l’autre. La majorité reste silencieuse : elle soutient sans chercher à en savoir davantage une politique de fait essentiellement sécuritaire et répressive.
Propos recueillis par Evelyne Damm Jimenez
